Rencontre avec Sika Fakambi

Compte-rendu de la rencontre avec Sika Fakambi du 25 novembre 2014, par Cécile Luherne et Margot-Zoé Renaux
 Sika Fakambi a traduit de l’anglais Snapshots : Nouvelles Voix du Caine Prize (collectif, auteurs d’Afrique anglophone), paru aux éditions Zulma en 2014, Notre quelque part, de Nii Ayikwei Parkes (Ghana), paru aux éditions Zulma en 2014 ; « Amarjit a le whisky amer » de Kirpal Singh (Singapour), in Miniatures Singapour, paru aux éditions Magellan & Cie en 2013 ; Carnet Bartleby et Georgia d’Andrew Zawacki (États-Unis), parus aux éditions de l’Attente et Pardon, de Gail Jones (Australie), paru aux éditions Mercure de France en 2008. Elle est membre de l’ école de Traduction Littéraire du Centre National du Livre.
Sika Fakambi a traduit de l’anglais Snapshots : Nouvelles Voix du Caine Prize (collectif, auteurs d’Afrique anglophone), paru aux éditions Zulma en 2014, Notre quelque part, de Nii Ayikwei Parkes (Ghana), paru aux éditions Zulma en 2014 ; « Amarjit a le whisky amer » de Kirpal Singh (Singapour), in Miniatures Singapour, paru aux éditions Magellan & Cie en 2013 ; Carnet Bartleby et Georgia d’Andrew Zawacki (États-Unis), parus aux éditions de l’Attente et Pardon, de Gail Jones (Australie), paru aux éditions Mercure de France en 2008. Elle est membre de l’ école de Traduction Littéraire du Centre National du Livre.
Un parcours entre les langues
Sika Fakambi est née et a grandi au Bénin entre les villes de Ouidah et Cotonou, au sein d’une famille mixte, franco-béninoise. Très tôt bercée par le fon, le mina et le yoruba, quelques-unes des langues couramment employées au Bénin, dont la langue officielle est le français, Sika Fakambi se reconnaît dès l’enfance un goût pour l’écriture et le passage d’une langue à l’autre.
Après avoir suivi des études littéraires en hypokhâgne et en khâgne à Paris, elle obtient une maîtrise de traduction littéraire à l’université de la Sorbonne-Nouvelle, poursuit un master en sous-titrage à l’université de Nanterre puis un master de traduction littéraire à l’université de Strasbourg. Dans le cadre de ses deux cursus en traduction littéraire, elle s’attelle à la traduction en français d’un recueil de nouvelles de l’auteur australienne Gail Jones. C’est une découverte décisive, que Sika Fakambi considère comme le moment où elle est véritablement entrée en traduction.
Elle effectue alors un stage aux éditions Denoël, traduit des articles de recherche pour des revues de sciences humaines et des critiques d’art pour des catalogues d’exposition, complète son parcours par une formation d’édition à l’ école des métiers de l’information à Paris, puis travaille comme correctrice à Courrier international et au sein des éditions d’Ithaque, où elle collabore à la traduction, à l’établissement et à l’édition de textes de psychanalyse et de philosophie. Cherchant à se consacrer pleinement à ses projets de traduction littéraire, Sika Fakambi s’éloigne par la suite du milieu de l’édition. Elle exclut également de faire du sous-titrage son activité principale, craignant de ne pas réussir à aménager suffisamment de temps et d’espace pour ses projets de traduction. Elle s’installe en 2011 dans la ville de Nantes, où elle se consacre entièrement à la traduction littéraire.
Elle choisit assez tôt au cours de ses études de partir à l’étranger et vit successivement dans plusieurs grandes villes anglophones, alternant années universitaires en France et années de voyage. Ses séjours à Dublin, Sydney, Toronto et Montréal lui permettent de faire l’expérience salutaire de ce qu’elle nomme’un troisième lieu’. Ce’troisième lieu’, c’est d’abord une forme d’alternative géographique, un intervalle neutre entre la France et le Bénin. C’est également le choix revendiqué d’être immergée’en périphérie’ des deux grands pôles de la langue anglaise, la Grande-Bretagne et les États-Unis.
Enfin, le’troisième lieu’ cristallise aussi l’enjeu et l’expérience même de la traduction, qui ouvre un espace entre les langues. Ce temps passé à l’étranger en étrangère, dans une langue qui n’est pas la sienne, lui permet ainsi de mûrir sa vocation et surtout son positionnement en tant que traductrice.
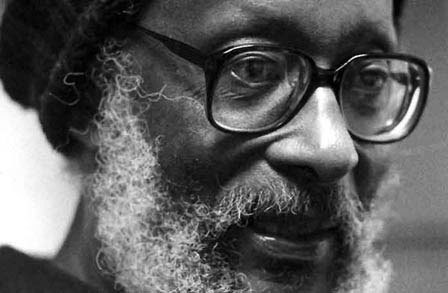 Saisie par la langue du poète de la Barbade Kamau Brathwaite, elle traduit quelques poèmes à partir d’enregistrements vocaux, puis présente son travail sous forme orale afin de rejoindre la puissance déclamatoire de ce poète du Spoken word. Sa traduction de Negus peut ainsi être entendue sur le site de la revue Retors. Il s’agissait, dans cette traduction, de’parvenir à transmettre la physicalité du texte, le rythme et la voix de Kamau Brathwaite’.
Saisie par la langue du poète de la Barbade Kamau Brathwaite, elle traduit quelques poèmes à partir d’enregistrements vocaux, puis présente son travail sous forme orale afin de rejoindre la puissance déclamatoire de ce poète du Spoken word. Sa traduction de Negus peut ainsi être entendue sur le site de la revue Retors. Il s’agissait, dans cette traduction, de’parvenir à transmettre la physicalité du texte, le rythme et la voix de Kamau Brathwaite’.
Pour sa traduction du premier roman de Nii Ayikwei Parkes, paru en France sous le titre Notre quelque part, Sika Fakambi a récemment reçu le prix Baudelaire et le prix Laure Bataillon (meilleuré ?uvre étrangère traduite en français de l’année).
Tail of the blue bird / Notre quelque part
’Quand je veux traduire un texte, je veux traduire la voix d’un texte. Donc je tends à l’incorporer, à le dévorer, ou si on veut, à le’vampiriser’. C’est vraiment très physique, je suis saisie par un texte, que j’entends d’une certaine façon, et que je veux traduire. C’est aussi pour cela que je travaille avec l’auteur le plus possible.’
 Le choix du titre français s’est fait d’un commun accord entre Sika Fakambi et Nii Ayikwei Parkes « Notre quelque part » reprend une expression du vieux chasseur Yao Poku, l’un des deux personnages narrateurs du livre, dont la voix ouvre le récit, le hante, et le clôt.’Yao Poku est la voix du village de Sonokrom’ déclare Nii Parkes lors de la remise du prix Laure Bataillon,’il est la voix de la vie quotidienne au village [...] et il représente l’amalgame de toutes les langues possibles du pays.’
Le choix du titre français s’est fait d’un commun accord entre Sika Fakambi et Nii Ayikwei Parkes « Notre quelque part » reprend une expression du vieux chasseur Yao Poku, l’un des deux personnages narrateurs du livre, dont la voix ouvre le récit, le hante, et le clôt.’Yao Poku est la voix du village de Sonokrom’ déclare Nii Parkes lors de la remise du prix Laure Bataillon,’il est la voix de la vie quotidienne au village [...] et il représente l’amalgame de toutes les langues possibles du pays.’Sika Fakambi raconte la manière dont elle s’y est prise pour retrouver la voix du vieux chasseur en français :’Dans le texte de Nii Ayikwei Parkes, j’ai retrouvé un usage des langues qui m’est très familier ; un usage des langues caractéristique des pays francophones ou anglophones d’Afrique de l’Ouest, où tout locuteur détient plusieurs langues qu’il utilise et entremêle au gré des circonstances, passant de l’une à l’autre, faisant danser son parler suivant l’interlocuteur, la situation ou le sujet de conversation. J’ai été saisie par ce qu’il avait fait en inventant la langue de ce chasseur... J’ai eu envie que cela existe en français. Retrouver ce que j’ai eu dans mes oreilles, dans mon enfance, parlant un français que l’on dit « classique » en plus du mina et du fon et de rudiment d’autres langues, mais aussi un français qui se déploie avec de nombreuses variations, un français augmenté par les langues africaines qu’il côtoie depuis la colonisation.’

« Elle portait une façon de jupe petit petit là. Et ça montrait toutes ses cuisses, s ?bi, mais les jambes de la fille étaient comme les pattes de devant de l’enfant de l’antilope - maaaigre seulement ! (C’est plus tard que j’ai appris qu’elle était la chérie d’un certain ministre. Hmm. Ce monde est très étonnant). »
Traduction de Sika Fakambi, Notre quelque part, éditions Zulma, Paris, p. 15.
Dans le discours du chasseur, Nii Parkes travaille la langue de façon singulière : il fait de l’anglais la langue étrangère (apparaissant en italiques), incorpore des mots en twi non traduits et utilise du pidgin (anglais « africanisé »). Sika Fakambi a pris le parti de respecter ces choix dans sa traduction. Pour discuter ensemble des équivalences, Sika Fakambi et Nii Parkes se sont parfois référés à des structures linguistiques et de pensée communes à leurs langues vernaculaires respectives, afin de trouver les justes ponts à établir entre les langues du Ghana et celles du Bénin.’ Chacune des langues qu’on entend dans le texte porte une vision du monde, une façon de voir, de sentir les choses et de les dire. C’était surtout à cela que tenait mon travail.’
« Traduire, c’est écrire »
’La part de subjectivité est à mon sens absolue’

Rejoignant plutôt les idées du théoricien Antoine Berman (l’auteur de L’ épreuve de l’étranger et de La Traduction et la Lettre ou l’Auberge du lointain), Sika Fakambi défend dans la traduction l’attention à la forme du texte, à son rythme et à sa voix propre. D’après Berman, la traduction est d’ailleurs avant tout une expérience, un travail sur la lettre qui n’est ni un calque, ni une tentative d’équivalence, mais la recherche d’un écho, qui prenne en compte l’étrangeté de la langue et ne cherche pas nécessairement à en « nettoyer l’obscurité ». En ce sens, comme l’affirme Sika Fakambi, « traduire est vite devenu la même chose qu’écrire. Traduire, pour moi, c’est écrire ». Écrire l’écho, au creux même de sa langue, de la langue d’un autre.
Billets
Le travail de Sika Fakambi en traduction relève d’un art qui n’a rien à envier à celui de l’écrivain. Son approche peut être décrite comme sincère, tant le rapport au texte relève d’une sorte d’empathie avec le langage. Les auteurs qu’elle choisit questionnent tous à leur façon ce lien étroit entre le mot et son sens, la forme porteuse d’une voix qu’elle dépasse pourtant. Les mots servent le sens, leur choix se travaille aussi dans la forme car’le texte est dans la forme’.
Que la traduction soit un travail créatif (dont le matériau manipulé avec virtuosité est la langue même) semble évident quand on comprend la perception de la littérature qu’a Sika Fakambi.’En l’occurrence, sa rencontre avec Nii Parkes semble extraordinairement idéale. L’un des plus grands charmes de Tail of the Blue Bird et ce qui participe de son originalité est l’intégration de la voix propre à chacun des personnages dans une double traduction, celle de l’oral vers l’écrit, et celle de la langue vernaculaire vers un anglais qui en reprend et en imite les structures et la sémantique. Comme un méta-langage, cette forme soutient une histoire questionnant justement les différences entre générations, entre ce qu’est le progrès en regard de la tradition, comment peut se vivre la concomitance d’une ouverture au monde et d’une culture ancestrale. La langue porte donc déjà elle-même beaucoup du sens implicite du roman ; les diverses formes que l’anglais y adopte tissent la trame d’un récit où les personnages diffèrent d’abord par leur culture, leur parcours, leur façon de s’exprimer... Tout cela se retrouve sans faille dans la traduction de Sika Fakambi.’
Sika Fakambi fait ses choix en fonction des rencontres qui la marquent et travaille portée par une voix, ne transigeant sur aucun point, du titre au média jusqu’à l’éditeur. Elle est discrète, travaille dans l’ombre’ comme le font aussi souvent les écrivains’ et sa façon de parler des textes est absolument fascinante. On sent sous une rigueur professionnelle très pragmatique une passion pour la langue et la littérature qui donne envie de repenser avec elle les enjeux de la traduction.’Certes, on regrette souvent de ne pas lire un auteur étranger’dans le texte’ pour jouir de son utilisation de la langue ; mais lorsqu’elle est faite à la façon de Sika Fakambi, la traduction sert au corps la littérature et rend ses richesses accessibles au-delà des frontières.
Cécile L.
Lors de cette rencontre, Sika Fakambi nous a fait entrevoir son imaginaire de la traduction. Il me semble que cela nous a permis, à nous tous qui l’écoutions, de réaliser à la fois la spécificité, l’ampleur et la beauté de ce travail de longue haleine, plongeant simultanément dans les tréfonds des intériorités et des altérités que porte en elle-même la littérature. La traductrice, garante de la transmission d’une voix, recueille le texte et y mêle sa voix propre, s’en faisant l’interprète, la passeuse, l’auteur en ombres chinoises.
Habitée par des voix auxquelles elle offre la possibilité d’une autre écoute, d’autres lectures, Sika Fakambi porte avec délicatesse et conviction la langue’ et sa pluralité intrinsèque’ jusqu’à faire émerger des points de résonance avec les potentialités du français, et nous y plonge avec elle.
Margot-Zoé R.
Par Cécile Luherne et Margot-Zoé Renaux
