Rencontre avec Pierre Senges

Compte-rendu de la rencontre avec Pierre Senges du 12 décembre 2016
par Mairame M’baye et Leïla Dijoux-Goalec
entretien réalisé par Vincent Message

De La Réfutation majeure à Achab (séquelles) en passant par Fragments de Lichtenberg, Pierre Senges est l’auteur de livres inclassables et intempestifs, qui redonnent vie à des figures littéraires ou explorent des pans du savoir avec une érudition joueuse. Publiée pour l’essentiel chez Verticales, son œuvre est considérée par la critique comme une des plus inventives et une des plus originales de sa génération. À l’occasion de sa résidence dans le master de création littéraire de Paris 8 Saint-Denis, il est revenu pour nous sur quelques-unes des lignes de force qui guident son travail.
« Écrire comme si un autre moi-même travaillait dans mon dos »
Avant l’écriture, la musique. Joueur de guitare et de saxophone, féru de jazz, Pierre Senges donne des concerts, enregistre des disques et dispense des leçons de musique. Ces leçons ayant généralement lieu en fin de journée, il commence dans les années 1990 à écrire le matin. Il entre dans le monde des mots de la même manière que dans celui des notes, en autodidacte. « C’est comme si l’écriture s’était faite malgré moi, dans mon dos, dans un travail de seconde main auquel je me livrais pour passer le temps ou pour prolonger la lecture. » Peu à peu, l’écriture prend plus de place et Pierre Senges divise ses journées : le matin il écrit, l’après-midi et le soir sont occupés par ses activités musicales. Alors qu’il est entouré de gens qui veulent écrire et qui vivent dans un imaginaire fantasmatique de ce que doit être un écrivain, Pierre Senges se consacre à l’écriture sans en faire un enjeu tétanisant. Il s’y livre de façon ludique, pour l’entraînement, comme un musicien fait ses gammes : en n’envisageant pas uniquement la création avec un grand C, mais en travaillant les mots comme il travaille son instrument, dans la répétition.
Le mouvement de bascule entre musique et écriture se fait sur une dizaine d’années. Son temps d’écriture est de plus en plus important, son travail de plus en plus systématique : il commence à le prendre au sérieux, sans que ce soit un sérieux de gravité, de prétention ou de sacralisation. En musique, il a le sentiment d’avoir atteint son seuil d’incompétence. Dans l’écriture il se sent plus à l’aise : il découvre le plaisir du travail solitaire, la sensation d’être maître de ses choix, quand il faut négocier chaque mouvement dès lors qu’on joue du jazz à plusieurs. Il fait l’apprentissage du travail d’écriture « pour le tiroir », sans publication envisagée, un travail « qui ne sert à rien sinon à me permettre d’arriver ailleurs. » À partir de 2000 et de la parution de son premier texte, Veuves au maquillage, il met de côté la musique et se consacre entièrement à la littérature.
« Fasse le ciel que je n’écrive pas de livre sur d’autres livres »
Les livres de Pierre Senges ne sont pas sous-titrés « roman ». Ils ne sont pas portés d’abord par la tension narrative ou la continuité d’une intrigue. « À un lecteur de Lawrence Sterne, je pourrais dire tout de même qu’il s’agit de romans’ car il en aura une idée assez large. » Le travail de Senges s’inscrit dans le sillage d’auteurs à la sensibilité baroque : Cervantes et Diderot dans la première modernité, Günter Grass, Carlo Emilio Gadda ou José Lezama Lima du côté de la littérature du XXe. Ce sont là des lectures qui ont compté pour lui au début des années 1990 : celles d’auteurs très généreux dans leur écriture, qui dépassent le roman non seulement par l’abondance de ce qui est dit, mais par la déstructuration de la phrase et l’usage de la métaphore. Des auteurs d’avant-garde, mais dont les références sont souvent des références anciennes, comme Joyce avec le Livre de Kells ou Jacques Roubaud avec les troubadours, comme si le dialogue s’établissait d’abord avec des arrière-grand-pères plutôt qu’avec des contemporains. L’enjeu, en revenant à ces œuvres anciennes, n’est pas de leur être fidèle mais de les reprendre dans une technique d’anamorphose, avec toutes les déformations de l’anachronisme.

« Fasse le Ciel que je n’écrive pas de livre sur d’autres livres ! » s’écrie le narrateur de Fragments de Lichtenberg (2008). Bravant cette interdiction ironique, Pierre Senges travaille sur des livres qualifiés de seconds, écrits dans la reprise d’un personnage, comme le capitaine Achab d’Herman Melville, ou d’un auteur, comme le philosophe et physicien Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799). Se greffer, dans une relation de parasitisme ou de commensalisme, sur un corpus déjà existant, est peut-être une façon de conjurer la solitude de l’écriture. Lorsqu’il écrit Lichtenberg ou Achab (séquelles) (2015), Pierre Senges peut ainsi faire semblant de se passer, momentanément du moins, de la question de la structure et de la forme, puisqu’une orientation est donnée d’emblée. « On met les pieds dans une maison déjà construite, avec des meubles. On n’a pas à créer ex nihilo. Pour écrire, on a besoin que le livre existe, soit donné comme déjà existant, alors que rien n’est là encore : partir d’ œuvres ou d’auteurs réels permet de surmonter ce paradoxe et cette angoisse-là. » Dans un deuxième mouvement, on s’éloigne de l’ œuvre existante sur laquelle on prend appui. Il faut se sentir le plus libre possible, quitte à ce qu’il n’en reste pas grand-chose. Cette approche reconduit néanmoins l’idée humaniste selon laquelle le livre est une conversation avec les morts.
Une jambe de bois et une bulle blanche

Plus que de personnages, les livres de Pierre Senges sont peuplés de silhouettes ou de figures. Tout en restant pour l’essentiel à l’extérieur de leur esprit, il les déploie en une arborescence de possibles et travaille sur leurs apparitions physiques : leurs jambes, leurs nez, leurs corps, qui se font parfois objets du récit, plus que leurs esprits, et ce afin d’éviter les personnages trop épais, durs et sûrs. Il est plus intéressant de travailler un personnage qui doute de lui, se remet en question, sait qu’il est déjà loin, dans un passé qui ne touche plus le présent et encore moins l’avenir.
Herman Melville, par exemple, fait vraiment d’Achab une silhouette dont l’apparition est retardée et qui est comme un trait noir. Sa jambe de bois est un masque, un détail qui fait oublier tout le reste. Achab est clos, laconique, monomaniaque, c’est un coffre fermé. Sa jambe pourrait être une faille, ouvrir une histoire, un passé douloureux, mais elle résume d’abord une biographie : c’est une manière forte de caractériser le personnage tout en se passant d’autres éléments. Achab se réduit à ce trait précis tandis que Moby Dick est une énorme bulle blanche : ce contraste est très frappant graphiquement.
Il a été difficile, précise Pierre Senges, de construire ce personnage qui n’est pas très aimé et de réussir par l’écriture à ce qu’il s’assouplisse, s’arrondisse. Il fallait le suivre dans différentes directions pour voir quelle chair il pouvait prendre, dans quel biotope il pouvait survivre. « Dans des pages que je n’ai pas forcément retenues, j’essayais de le faire parler à la première personne, pour voir quelle parole tenait au personnage. Je sais, en les faisant, que je ne vais pas garder ces pages, c’est de la matière inutilisable, mais utile pour des choix ultérieurs. Écrire est souvent la meilleure façon de savoir ce qu’il ne faut pas faire : quand on est sur une bonne piste, on ne le sait pas toujours, mais quand on est mal engagé on le sait frontalement, rapidement, d’où l’idée d’épuiser les mauvaises pistes pour ne garder que les bonnes. »

Ce qui est essentiel, dans ce traitement des personnages, est de s’interroger sur les modalités de leur métamorphose : il faut user de fuites, rendre compte des fluctuations, s’occuper du mouvement, de la résistance aux contraintes d’un système, comme le dit Gilles Deleuze à partir notamment de sa lecture de Melville. Le devenir du personnage a plus d’intérêt que son état. Le voyage, le vieillissement, les trahisons, les ruptures, ces moments où on veut être autre et où on quitte les autres, le changement de nom, décisif en Amérique pour faire peau neuve, pour tenter de se fonder comme self-made man alors qu’il y en a en réalité si peu : tout cela permet de ne pas s’en tenir à une vision fixiste des êtres, qui séparerait les innocents et les coupables, les sachants et les ignorants, et de plutôt les inscrire dans le temps qui leur permet de se distinguer de versions antérieures d’eux-mêmes.
De l’art de brouiller le vrai et le faux

Dans tous les cas, Pierre Senges se soucie peu de la vraisemblance historique ou sociologique des discours qu’il convoque : ce qui compte pour lui est leur efficacité dramaturgique et littéraire. Dans La Réfutation majeure (2004), en attribuant à Antonio de Guevara tout un livre destiné à réfuter l’existence de l’Amérique, il joue d’une écriture assez datée, même si elle ne prétend pas imiter la syntaxe et la grammaire de 1520. Pierre Senges poursuit dans ce texte le brouillage du vrai et du faux très prégnant chez des auteurs postmodernistes comme Jorge Luis Borges ou Umberto Eco. Toutes les preuves de l’inexistence de l’Amérique que le livre recense ont à un moment donné été avancées, mais Guevara les interprète de manière paranoïaque. Façon aussi de réfléchir à la gloire absolue que connaissent les théories du complot. « Plus on avance des preuves pour démontrer que A, plus les tenants de B vont s’en emparer pour prouver au contraire que B : c’est affligeant dans le monde réel, mais intéressant littérairement car cela joue sur des principes proches de ceux de l’analogie et de la métaphore. » Guevara est un complotiste subtil, pas un va-t-en-guerre épais. C’est aussi un perdant, qui donne l’impression de savoir qu’il fait partie du Vieux Monde, mais qui s’y accroche car le Nouveau Monde ouvre un avenir auquel il ne peut pas s’identifier.
La fréquentation de la littérature dans son temps long incite Pierre Senges à une forme de prudence quand il s’agit d’aborder les débats actuels sur la post-vérité. L’historien Roger Chartier montre déjà, rappelle-t-il, que l’imprimerie à son invention était crainte pour sa capacité à répandre les fausses nouvelles. Et la question du trop de livres qui ferait vivre dans un monde d’illusions est au cœur de Don Quichotte : si on brûle ses livres, c’est parce qu’on le suppose malade de fiction, comme aujourd’hui on suppose les gens malades de jeux vidéos ou d’internet. La politique-spectacle, elle, n’a pas attendu la télévision : Napoléon prenait des cours de maintien auprès du comédien François-Joseph Talma, et on reprochait à Néron de se comporter en pitre. La fausse référence et la fausse bibliographie sont aussi des pratiques anciennes, comme l’ont montré les travaux de Carlo Ginzburg. La paranoïa dans la littérature à la manière dont la pratiquait Nabokov est un délice, mais la paranoïa dans la vie, en tant que pathologie, est un supplice. L’esthétique en fiction permet en fin de compte de jouer de ce qui est détestable dans la réalité.
En écrivant La Réfutation majeure, Pierre Senges s’est demandé s’il fallait indiquer comme nom d’auteur Antonio de Guevara et dissimuler son nom à lui. Mais il s’est rendu compte que le lecteur serait assez vite au courant de l’imposture, et que le livre devait continuer de vivre au-delà de cette révélation. C’est un livre écrit avec la complicité du lecteur, et non pas pour le berner. Il ne s’agit pas de trouver un usage à la littérature, explique Senges, mais s’il fallait tout de même en imaginer un, ce serait de nous rendre plus exigeant dans notre demande de vérité mais aussi dans notre demande de fiction.Comme l’œil du spectateur s’est habitué aux trucages de film et ne veut plus les voir, la pratique de la lecture et de l’écriture doit permettre une crédulité ou une incrédulité plus exigeantes. « Tomber sur un mauvais faussaire, il n’y a rien de pire. Si on se fait berner par quelqu’un de grossier, on subit une double défaite. » Pierre Senges plaide donc pour une écriture qui nous habitue à des mensonges plus subtils.
« L’écriture tôt ou tard nous dit de quoi on parle, ce sur quoi on écrit. »
Comment naissent les livres de Pierre Senges ? L’auteur part du principe que les livres émergent du mouvement même de l’écriture. Les brouillons jouent ainsi dans son travail un rôle tout à fait décisif. « Je ne commence pas « un roman ». J’accumule des tas de papiers, et au bout d’un moment j’essaye d’en tirer quelque chose. » Pierre Senges a qui plus est la particularité de continuer d’écrire à la main, parce qu’il aime conserver un rapport concret et matériel à ce qu’il écrit. Sa main est plus lente que ses doigts sur un clavier d’ordinateur, ce qui lui permet de développer sa pensée au fil de l’écriture. C’est un jeu dans lequel il faut accepter la part que prend l’oubli, puisque les idées disparaissent parfois aussi rapidement qu’elles jaillissent. Ses brouillons sont faits de phrases longues, comme ses livres, et il ne s’y autorise pas la rature : prolonger le plus possible une phrase écrite permet de dépasser les premières idées et de voir la phrase échapper, aller dans des directions imprévues. On commence à écrire sans avoir en tête la fin de la phrase, ce qui suppose à la fois un laisser-aller et beaucoup de métier’ à la manière du dessinateur Nicolas de Crécy, qui ne passe pas par des crayonnages préalables. Il faut parvenir à « travailler en dormant », selon son expression, à savoir maintenir une tension entre une libre association d’idées et une pensée plus ordonnée : entre la métaphore et la structure syntaxique.
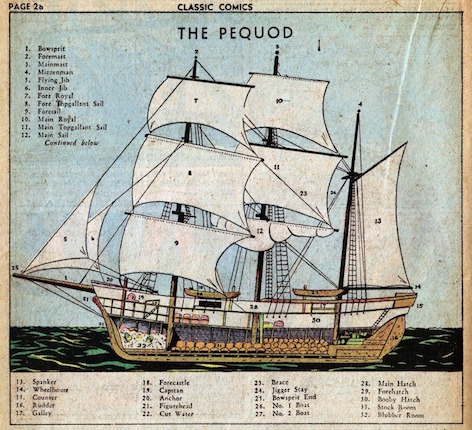
Après cette première phase, Pierre Senges recopie ses textes sur ordinateur. C’est une période assez chagrine, car il jette généralement les deux-tiers du matériau rassemblé. À la grande liberté du brouillon se substitue la frustration de devoir choisir une trame, une structure. C’est pour maintenir autant que possible cette liberté initiale que Senges choisit de donner à ses livres une forme éclatée.
La genèse des livres de Pierre Senges passe aussi par beaucoup de lectures en bibliothèque. Lorsqu’il étudiait la sociologie à l’université, la bibliothèque lui était déjà plus familière que les amphis. Mais si la recherche et la documentation sont des étapes importantes, il insiste sur la nécessité de ne pas les prendre trop au sérieux : ce qui l’intéresse n’est pas la précision mais l’élan. « J’essaye de ne pas écrire avec de la documentation à côté, de travailler plutôt de mémoire, en amateur, en chapardeur, et peu importe si je me trompe : si vraiment c’est nécessaire, je rectifierai plus tard. La documentation n’est pas intéressante si elle est convoquée de manière trop rigoureuse, il vaut mieux en être familier et en avoir une mémoire un peu flottante. »
Dialoguer avec l’éditeur pour penser la place du lecteur

Pierre Senges parle des projets à ses éditeurs de chez Verticales, Yves Pagès et Jeanne Guyon, lorsqu’il est à peu près sûr qu’ils vont déboucher sur des livres et qu’il a déjà accompli les 9/10e du travail. Il leur donne donc des manuscrits presque achevés, tout en comptant beaucoup sur leurs retours de lecture, puisque tous deux sont capables de voir les points de déséquilibre d’un livre de 650 pages. « En relisant, j’essaye de couper tout ce qui paraît inutile, même si un livre est toujours fait de choses inutiles. Je coupe ce qui m’ennuie : une pensée molle, des poncifs, des choses redondantes. »
Dans ce travail avec l’éditeur, une des questions centrales est de savoir comment inviter le lecteur dans le livre. « À partir de la page 150, si le lecteur est encore là, il peut s’y orienter tout seul. Mais il faut l’inviter. » Ce qui suppose de ne pas poser toutes les difficultés ou tous les pièges d’emblée, et à l’inverse, plus tard, de briser la routine qu’il pensait voir se dessiner, de perturber l’organisation mise en place. On peut alors jouer avec le lecteur et non pas se jouer du lecteur.
Dissimuler les aphorismes, accepter les fragments
La réflexion sur le fragment est au cœur de Fragments de Lichtenberg. Lichtenberg a laissé à sa mort une malle remplie de feuillets, de 8000 morceaux de prose en vrac. Le livre suit son histoire, mais aussi celle des lichtenbergiens qui font l’hypothèse qu’il s’agit d’un livre complet, et qui essayent de le reconstituer. À travers cette histoire, il nous semble que Pierre Senges nous parle de notre difficulté à accepter le fragmentaire, du goût de l’esprit pour la totalité, de toutes les absurdités ou de toutes les violences dont nous sommes capables pour atteindre la totalité même quand elle est dangereuse ou illusoire.
Mais tout en pratiquant une écriture fragmentaire, Pierre Senges se méfie de l’aphorisme, qui souvent tombe à l’eau. Les bons auteurs d’aphorismes sont selon lui très rares : en général, la mise en exergue affadit. L’art de l’aphorisme consiste plutôt à ne pas mettre en avant ses effets, à les faire passer sous le manteau. Chez Proust ou Grass, les énoncés de vérité générale participent d’un art de la dissimulation. Chez Lichtenberg ou Novalis, qui ont tous deux pour modèle lointain Pascal, l’idée est de lutter contre la vanité de tout comprendre, de montrer le ridicule du système. Pour ne pas tomber dans le sentencieux, il faut donc les inclure dans un ensemble plus prosaïque, lourdaud, faussement paysan : mettre en avant quelque chose de très visible, qui peut tenir du leurre, et glisser, mine de rien, l’essentiel. C’est la sprezzatura : être élégant en faisant semblant qu’on ne l’est pas.
par Mairame M et Leïla Dijoux-Goalec
