Rencontre avec André Markowicz

Compte-rendu de la rencontre avec André Markowicz du 13 février 2017
par Stéphanie Arc, Caroline Boulord et Woosung Sohn
Entretien réalisé par Vincent Message

Né à Prague en 1960, d’une mère russe et d’un père français d’origine polonaise, André Markowicz quitte la Russie pour la France à l’âge de 4 ans. Depuis, il dit ne s’être jamais senti véritablement ni russe ni français. C’est dans ce territoire d’entre-deux que se situe pour lui le lieu de la traduction. Entre deux langues, entre deux modes de pensée, entre deux mondes.
Il est un des rares traducteurs à avoir acquis le statut d’auteur en France. Cette position particulière, il pense la devoir aux rencontres décisives qu’il a pu faire, notamment celle d’Hubert Nyssen, le fondateur des éditions Actes Sud, au moment où se lançait la collection Babel, puis celles d’Antoine Vitez, Georges Lavaudant et Benno Besson, les plus grands metteurs en scène de l’époque, avec qui il a eu la chance de travailler au théâtre.
« Au début, je ne vivais de rien, je n’avais pas d’argent du tout. En 1991, Georges Lavaudant m’a commandé Platonov, de Tchekhov. J’ai alors appris qu’il fallait adhérer à la Société des auteurs dramatiques, la SACD, et je leur ai demandé une avance, pendant que ça se jouait. On m’a proposé 100.000, j’ai cru que c’était en anciens francs’ Mais non, c’étaient 100.000 francs nouveaux, ce qui m’a permis d’acheter un appartement à Pétersbourg. »
Fait rare dans le parcours d’un traducteur, André Markowicz a ensuite pu vivre de son travail, proposant lui-même des œuvres à traduire aux éditeurs, sans avoir besoin d’accepter des commandes qui ne l’intéressaient pas. Certains des textes qu’il a traduits restent inédits, car ils ne correspondent pas à une demande précise et qu’il n’arrive pas à convaincre d’éditeur de se lancer dans leur publication. Cela n’empêche pas André Markowicz d’y travailler pour lui-même : « Passer sa vie au contact de choses tellement belles, mais qu’est-ce que tu veux faire de plus ? »
Eugène Onéguine, l’alpha et l’oméga
Son nom est associé à l’ œuvre de Dostoïevski. L’histoire est connue : en 1990, au sortir d’une entrevue avec l’écrivaine Nina Berbevora dont il a traduit un livre, L’Affaire Kravtchenko, André Markowicz convainc Hubert Nyssen de la nécessité de retraduire Dostoïevski. Tout Dostoïevski. « Les versions existantes », argumente-t-il avec ferveur sur un quai de métro, « sont de belles infidèles : elles policent le style de l’écrivain russe, elles le rendent élégant, elles le « francisent ». Or Dostoïevski met en jeu les niveaux de langue les plus variés, des plus vulgaires aux plus nobles. » Hubert Nyssen le suit. André Markowicz a des pouvoirs d’enchanteur, son engouement emporte l’adhésion : en douze ans, il publiera vingt-neuf tomes chez Babel, renouvelant notre approche de la littérature russe et contribuant à l’essor des éditions Actes Sud. À l’en croire, pourtant, ce n’est pas là son grand œuvre. « En traduisant Dostoïevski, je voulais m’approcher de Pouchkine. Tous les romans de Dostoïevski sont écrits sur un thème de Pouchkine, à commencer par Crime et Châtiment qui part d’une question sur Napoléon :’Pourquoi Napoléon a-t-il le droit de tuer des millions de personnes alors que je n’ai pas le droit de tuer une vieille bonne femme ’ ? ». Parmi la centaine d’ œuvres qu’il a traduites’ dont le théâtre complet de Tchekhov, avec Françoise Morvan, et une quinzaine de pièces de Shakespeare’, c’est ainsi Eugène Onéguine, d’Alexandre Pouchkine, qui s’avère selon lui’ de loin !’ ce qu’il a réalisé de plus important dans sa vie.

Mais pourquoi ce roman en vers, à première vue un peu mièvre, revêt-il une telle importance, s’interrogent les lecteurs français perplexes qui, de la littérature russe, retiennent surtout Dostoïevski, Tolstoï et Tchekhov ? Il y a d’abord la « petite » histoire, celle du jeune Markowicz : « Ma première langue, ce n’est pas le russe, c’est Pouchkine. Dès mes premières semaines, ma grand-mère, qui ne chantait pas, me lisait ses contes pour m’endormir, et ma maman connaît les 6500 vers d’Eugène Onéguine par cœur. Elle les récitait pour conjurer sa peur lors des bombardements du blocus de Léningrad, cela calmait les autres enfants et cela l’a aidé à tenir. » C’est aussi l’histoire d’une vocation : à 18 ans, pour les éditions L’âge d’homme, André Markowicz commence à traduire Pouchkine à la demande d’Efim Etkind, qu’il considère comme son maître. Dissident soviétique qui a choisi l’Ouest et s’est installé en France, Etkind est un brillant traducteur et universitaire russe qui a aidé à sortir du pays le manuscrit de L’Archipel du Goulag de Soljenitsyne. C’est enfin l’histoire de la littérature et de la langue russes elles-mêmes : avant Pierre le Grand, qui fait passer la Russie aux Lumières en quelques années, au prix de milliers de morts, la littérature russe est une littérature médiévale. Elle naît à la modernité en 1810-1820, autour du cercle de Pouchkine. Le russe devient d’un seul coup une langue littéraire. Œuvre inscrite dans la mémoire collective russe, Eugène Onéguine est, d’après Bielinski, une « encyclopédie de la vie russe », qui offre une citation pour chaque situation de la vie. C’est enfin un texte porteur d’énigmes irrésolues, puisque Pouchkine a omis beaucoup de strophes fantômes, brûlant notamment le chapitre 8, sans doute après qu’il a été censuré par le tsar.
Si, derrière son apparente simplicité, Eugène Onéguine représente l’horizon ultime de la traduction, c’est parce qu’il est un hymne à la joie inégalé. L’œuvre détonne par sa légèreté : « La littérature russe est une littérature lourde, idéologique, comme le pays. Tous les écrivains russes aux XIXe et XXe siècles sont barbus, c’est-à-dire qu’ils vous apprennent comment il faut vivre, tous’ sauf Pouchkine ! Lui ne veut rien imposer. Il mobilise une richesse infinie d’intonations pour apparemment dire des riens. » Eugène Onéguine ne vaut pas tant pour son sens (« il n’y en a pas ») que pour ses innovations formelles, subtiles et surprenantes, dont une strophe particulière inventée par Pouchkine qui, composée de quatorze vers, alterne quatrains à rimes croisées ou embrassées et rimes plates.

L’histoire que raconte le livre est en effet ténue : le héros, dépressif, s’ennuie à la campagne. Il rencontre Tatiana, la fille de voisins, qui tombe amoureuse de lui. Onéguine rejette ses avances. Lors d’un bal, il fait la cour à Olga, la sœur cadette de Tania, provoquant la colère de son ami Lenski qui prétend à la main d’Olga. Les deux hommes se retrouvent pour un duel, et Onéguine tue Lenski. Plus tard, il quitte la campagne, et après des voyages, retrouve Tatania à Petersbourg : elle est désormais mariée à un noble. Il en tombe amoureux, mais c’est elle qui cette fois rejette ses avances. À partir de cette intrigue simple, Pouchkine fait preuve d’une inventivité formelle extraordinaire, de vertus stylistiques aériennes qu’André Markowicz transcrit en français en inventant ses propres procédés.
Pour mener à bien cette entreprise délicate, il transcende le tétramètre iambique’ constitué de quatre unités de deux syllabes, avec accent sur les syllabes paires’ en rapprochant le vers français, syllabique, du vers russe syllabotonique, basé sur la succession de syllabes accentuées. Sa méthode ? Traduire à l’oreille. « À force de me répéter le texte russe, certaines phrases devenaient françaises », raconte-t-il. Et de fait, à la lecture, nous entendons bel et bien résonner les vers par les « oreilles des yeux », comme si nous lisions le texte à voix haute : c’est une mélodie joyeuse.
Un autre souci constant du traducteur d’Onéguine est de saisir l’ironie du texte, cette distanciation drolatique, qui en est la caractéristique principale : à l’instar de Sterne dans Tristram Shandy ou de Byron dans Don Juan, Pouchkine joue au chat et à la souris avec le lecteur, notamment par l’inclusion des strophes fantômes et par des mises en abymes fréquentes. Ventriloque, il emprunte la voix d’un narrateur dont il ne dévoile pas l’identité, il digresse, il moque sa propre langue pleine d’expressions toutes faites, il cite ses amis poètes et tourne en dérision son héros, auquel il semble pourtant finir par s’attacher.
Mais le tour de force de cette traduction, lié à l’innovation majeure de Pouchkine, réside dans l’emploi d’une langue « objective » : pour chaque situation évoquée, l’écrivain utilise systématiquement, non pas une langue personnelle, mais le lieu commun approprié (un vocabulaire usé, des métaphores éculées’) « Ce qui caractérise le texte, c’est qu’il n’y a pas une langue : chaque style a sa langue. Pour parler de son héros qui mène la vie d’un mondain du XVIIIe siècle, il cite par exemple constamment Voltaire. » De même, pour composer la déclaration d’amour de Tatiana à Onéguine, qui est la première déclaration d’amour en russe de la littérature, puisque la correspondance sentimentale de la noblesse russe était d’ordinaire écrite en français, Pouchkine part de l’élégie de sa contemporaine Marceline Desbordes-Valmore et l’utilise comme un topos : il gomme son originalité qui réside dans un usage du « tu » dès la première phrase, et revient à la tradition qui consiste à débuter au « vous » puis à passer au « tu » en cours de route. « Cette écriture du lieu commun s’oppose au romantisme, qui est une écriture de l’individu et du je. » Pouchkine considère que le vrai romantisme n’est pas celui de Hugo, qui pose la distinction entre le grotesque et le sublime même s’il dit vouloir la dépasser, mais celui de Shakespeare, pour qui le grotesque peut être sublime et le sublime grotesque, de sorte qu’ils ne peuvent pas constituer deux catégories séparées. « Cette historicité de la langue de Pouckhine est d’autant plus intraduisible que plus personne ne connaît les modèles’ C’est à la fois extrêmement savant et très très simple », conclut André Markowicz.
« Quand j’ai achevé mon travail sur Eugène Onéguine, j’ai su que jamais je ne ferais mieux. Je n’avais plus qu’à sauter par la fenêtre, pour finir en beauté en quelque sorte ! Mais, bon, je vais attendre encore un peu’ Toutes les traductions suivantes, c’était comme du surplus. Je pouvais donc me permettre Ombres de Chine. »
Ombres de Chine - Traduire une langue inconnue
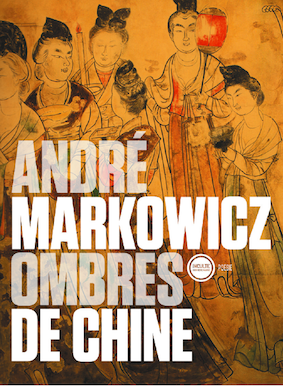
Comme Eugène Onéguine, Ombres de Chine, recueil de poèmes de l’époque Tang (entre les VIIe et IXe siècles de notre ère), paru aux éditions Inculte en 2015, est une histoire d’adolescence. Et « un chemin sur des décennies » pour ce traducteur qui ne recule pas devant les entreprises au long cours. « Quand j’étais adolescent, Efim Etkind m’a offert trois petits livres de poèmes chinois de Li Po, Tu Fu et Wang Wei, magnifiquement traduits par Alexandre Guitovitch, et cela m’a bouleversé. » André Markowicz, qui ne lit pas le chinois, découvre donc ces œuvres en russe, avant de consulter plus tard leurs traductions faites en anglais, en italien, en espagnol et en français par des spécialistes dont on ne peut remettre l’expertise en cause. Or les différences qu’il constate entre les versions « sont tellement majeures que tu as l’impression de ne pas lire le même texte ». Doit-on en déduire que tous se trompent ? « Visiblement, c’est plutôt qu’aucun n’a raison ou tort : le poème chinois, non content d’admettre la pluralité d’interprétations, la demande’ En chinois, la notion même de sens est différente. » La découverte de L’écriture poétique chinoise, de François Cheng, constitue par ailleurs pour lui une véritable « invitation à la traduction ». Paru en 1977, cet ouvrage, qui analyse les règles et la structure de la poésie chinoise, « est le premier livre dans lequel on explique concrètement comment elle est écrite, comment elle fonctionne. » François Cheng y fournit le texte original, une traduction mot à mot ainsi qu’une proposition de traduction poétique. Fasciné par ces textes, André Markowicz décide au début des années 2010 de réunir et de traduire quatre cents poèmes de douze auteurs, presque tous inédits en France.
Ombres de Chine est avant tout un recueil de recherches poétiques, voire archéologiques. « Il s’agit plus d’un livre de réécriture que d’un livre de traduction », précise André Markowicz, qui a comparé les différentes traductions des poèmes pour en transcrire le sens et la forme en ne visant dans cette entreprise aucune forme de vérité. Traduire du chinois est pour un Occidental une gageure en soi. Les idéogrammes sont en effet « des compilations d’étymologie par le dessin, donc en eux-mêmes intraduisibles ». Il n’y a en mandarin ni conjugaison, ni temps, ni genre, ni nombre. L’optatif, l’indicatif et l’infinitif y prennent tous la même forme, et le pronom personnel est souvent omis. À part le contexte, rien ne permet donc de différencier l’énoncé « elle allait » de l’énoncé « ils iront ».
Par ailleurs, alors que le chinois est une langue monosyllabique, les poèmes classiques de l’époque Tang sont composés de cinq ou sept caractères. André Markowicz, dont le travail est une perpétuelle recherche d’équivalence, en premier lieu celle de la forme (« Je traduis un poème écrit en alexandrins par un poème écrit en alexandrins »), opte pour une traduction en décasyllabes pour donner une régularité au texte et pouvoir jouer sur la césure. « Ce vers de dix pieds est capital pour moi, parce que c’est le pentamètre iambique, celui de Shakespeare, de Pouchkine, et de beaucoup d’autres poètes. » Il choisit enfin de ne pas chercher la rime, parce qu’il ne la sent pas en chinois et que ce qu’il entreprend n’est pas tout à fait une traduction, mais autre chose’
Si la rencontre de ces poèmes écrits en mandarin du VIIIe siècle est l’occasion pour lui d’appréhender une pensée radicalement nouvelle, elle permet aussi à André Markowicz de découvrir une guerre civile dont on parle peu, bien qu’elle soit le plus grand massacre de l’histoire avant la Seconde Guerre mondiale : celle qui eut lieu en Chine lors de la révolte d’An Lushan (755-763) et qui fit passer la population chinoise de soixante millions d’habitants à seize, en huit ans. Cette tragédie oubliée fait écho pour lui au XXe siècle qui a connu le nazisme, le stalinisme et le maoïsme. « Mon sujet c’est la confrontation avec l’Histoire, la manière dont l’Histoire brise une génération. » Or la plupart de ces poèmes ne glorifient pas la guerre, mais en disent les ravages avec « un humanisme, une tendresse, une fraternité stupéfiantes. » Ils montrent ainsi comment un monde culturel radicalement différent du nôtre, qui semble a priori lointain au point d’en être incompréhensible, peut devenir le miroir de notre expérience.
« Mes poèmes’non traduits’, écrit André Markowicz dans la préface d’Ombres de Chine, sont construits sur le besoin de faire advenir, en français, des ombres rayonnantes, des présences, ce que j’appelle des « figures ». Le personnage brasille à la limite de l’apparition, [’] se forme et se dissout, se recompose dans le passage d’une langue à l’autre, du monde sans parole que chacun porte en soi au monde matériel des mots offerts à lire. À chaque fois, d’une manière ou d’une autre, il s’agit de tracer les contours de cette ombre [’]. C’est de la même façon que j’ai voulu tracer les contours de ces Ombres de Chine, au début pour moi-même, puis, au fur et à mesure qu’une sorte de continent se découvrait à moi, pour partager cette découverte et la prolonger. »
« Je suis un traducteur russe qui écrit en français »
André Markowicz conçoit la traduction comme une forme d’écriture à part entière : « Quand on traduit, on écrit. » Mais l’inverse lui paraît juste aussi : « Quand on écrit, on traduit toutes sortes d’expériences et de lectures. Une traduction est la traduction d’un texte. L’écriture est la traduction d’une vie. »
Avec le recul, le travail de traduction d’André Markowicz lui paraît s’orienter dans deux directions principales : un intérêt pour la traduction du vers, des différents vers de la tradition poétique occidentale, et un intérêt pour le travail sur la voix’ sur la manière dont l’écrit peut rendre les inflexions de la voix humaine.
Dans tous les cas, il lui paraît essentiel de respecter les choix formels des auteurs. « Si je ne peux pas traduire la forme, je ne fais pas la traduction. » Il critique à cet égard « l’absolue surdité de la littérature française aux formes étrangères », en particulier dans le domaine de la poésie. « Comment, par exemple, traduire la Divine Comédie sans la tierce-rime alors que tout va par trois dans ce texte et que cette tierce-rime est pour Dante, au sens strict, la preuve de la présence de Dieu, de la Trinité ? De même, le fait que Shakespeare soit traduit en prose ou en vers libres ne dérange personne en France. Alors que lui-même fait la différence entre passages en prose et passages en pentamètres iambiques : dans Hamlet, par exemple, les passages en prose sont les plus philosophiques. Et naturellement, ces différences sont importantes du point de vue dramaturgique. »
En outre, il avoue ne pas traduire de littérature contemporaine : d’abord pour ne pas avoir affaire aux auteurs et ne pas risquer de perdre du temps en embrouilles éditoriales, mais aussi parce que chaqué ?uvre qu’il choisit de traduire est une manière de se confronter avec l’Histoire. « Pour être traduit par André Markowicz, il faut que tu sois crevé. Et il n’y a aucune exception à la règle. »

Il raconte souvent une anecdote déterminante dans sa découverte de Tchekhov, qu’il n’aurait jamais traduit sans Françoise Morvan. Lorsqu’ils se rencontrent en 1985, André vient de recevoir une commande : la traduction d’une vingtaine de nouvelles de Tchekhov. Il envoie à Françoise les épreuves du Malheur des autres. Au bout d’une semaine, elle lui propose des corrections qui lui paraissent rapprocher le texte de sa version russe, alors qu’elle ne parle pas du tout la langue. En particulier, elle lui répond : « Mais vous n’avez pas le droit de traduire ça comme ça, parce que vous n’avez pas senti l’odeur du foin sous la pluie. » Un commentaire qu’il ne comprend pas aussitôt. Elle vise en fait à lui montrer un aspect du texte à côté duquel il est passé : ce détail s’inscrit dans la description d’un domaine agricole. « Or si vous laissez le foin sous la pluie, c’est que, l’hiver suivant, les bêtes n’auront rien à manger. Laisser le foin sous la pluie, c’est la mort. Cela signifie que le domaine est en déreliction. » Il réalise alors que la traduction n’est pas seulement une question de langue, mais d’expérience humaine. Si la collaboration avec Françoise Morvan a été aussi utile pour traduire Tchekhov, c’est donc entre autres parce qu’elle a grandi à la campagne et a une compréhension profonde de la nature et du monde rural. « Dostoïevski ne décrit pas la nature. Il y a chez lui deux catégories métaphysiques : l’arbre et le mur de briques. Mais pour Tchekhov, « l’arbre », cela n’existe pas, il n’y a que des arbres singuliers. »
« Traduire, c’est partager »
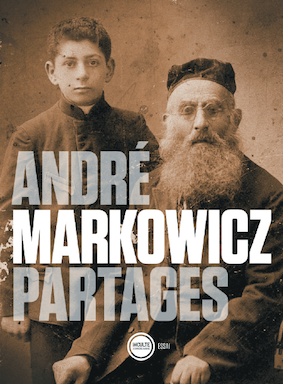
Le 26 août 2015 paraît Partages aux éditions Inculte, sorte de journal de bord de l’écrivain. Un an plus tard, un second volume, Partages vol. 2, sort chez le même éditeur. Les deux ouvrages rassemblent chacun une année de chroniques publiées par André Markowicz sur Facebook, où se mêlent questions sur son travail de traducteur, lectures, réflexions, souvenirs, poèmes... Depuis juin 2013, il publie un texte tous les deux jours sur le réseau social.
L’utilisation de ce média est un véritable choix de sa part. Le fait que Facebook soit un espace qui n’accueille pas que des productions légitimes, mais un espace où peut se dire n’importe quoi, a libéré André Markowicz d’une certaine phobie de la page blanche. La présence d’un public incarné, d’amis et de contacts à qui on s’adresse de façon très concrète rejoint aussi son travail sur la voix, sur l’écrit en tant qu’il est dit : « Ce qui m’intéresse est de parler à des gens. » Et contrairement à un blog qu’il faut faire la démarche de consulter, les contenus publiés sur Facebook sont pris dans le courant, dans la banalité la plus totale. La traduction et la poésie ne sont donc plus un domaine réservé, mais des pratiques qui s’insèrent dans le flux de la vie quotidienne. Le succès de la page d’André Markowicz confirme ces intuitions, puisqu’environ 12.000 personnes y sont abonnées et lisent ses posts plus ou moins régulièrement.
Attaché à l’objet livre, André Markowicz a tenu à réunir ses chroniques sous une forme papier. Le livre a aussi l’avantage de proposer une table des matières et un index, donc de se parcourir plus facilement qu’une page Facebook. Le titre a été trouvé par Françoise Morvan, et André Markowicz l’a reçu comme une évidence, car traduire consiste avant tout pour lui à faire connaître ce qu’il aime. « Partager, c’est la définition basique de la traduction. » Si le premier tome de Partages, actuellement épuisé, s’est bien vendu et a connu une réception critique importante, liée sans doute à la nouveauté de l’entreprise, le deuxième n’a pas rencontré le même succès. André Markowicz pense que la mention Volume 2 a effrayé certains lecteurs qui ont pu penser qu’il fallait, pour s’y plonger, avoir lu le volume 1. Indiquer l’année d’écriture de ces chroniques aurait peut-être été plus judicieux. Sans savoir encore s’il y aura un troisième volume, André Markowicz poursuit ses chroniques, qui font découvrir à un public important des pans méconnus de la littérature russe, ainsi que les réflexions qu’un des traducteurs majeurs de notre présent peut se faire au jour le jour sur les enjeux de son métier.
par Stéphanie Arc, Caroline Boulord et Woosung Sohn
