Rencontre avec Marie Darrieussecq

Compte-rendu de la rencontre avec Marie Darrieussecq du 20 mars 2017
par Allan Deneuville, Stéphanie Vivier et Guillaume Wavelet
crédits photo : Jose Goitia, Jean-Paul Hirsch
entretien réalisé par Vincent Message

En 1996, à 27 ans, Marie Darrieussecq fait une entrée plus que remarquée sur la scène littéraire française avec son premier livre, Truismes. Traduit dans une quarantaine de pays, ce roman ouvre uné ?uvre où les questionnements sur les identités de genre se mêlent à l’influence de la psychanalyse et à une réflexion sur nos territoires politiques et imaginaires. Aujourd’hui auteure d’une quinzaine de romans, tous parus aux éditions POL, dont le dernier, Il faut beaucoup aimer les hommes, a obtenu le prix Médicis, elle est également traductrice (Un lieu à soi de Virginia Woolf, Tristes Pontiques d’Ovide) et essayiste (Rapport de police, être ici est une splendeur).
Une écriture hantée
Le fantôme est une figure récurrente dans les romans de Marie Darrieussecq. Dans Le Pays, il prend la forme d’un hologramme à l’image de la grand-mère de la narratrice. Dans ce roman par ailleurs très intimiste et réaliste, un passage presque science-fictionnel décrit un lieu de recueillement numérique, une sorte de cimetière virtuel, « la maison des morts », où les défunts sont informatiquement modélisés par les familles endeuillées.
Dans Tom est mort, la narratrice qui a perdu son fils est à la recherche de son fantôme. Elle croit percevoir une présence dans son appartement et enregistre minutieusement le silence afin d’y percevoir une trace sonore de Tom. Bien que Marie Darrieussecq reconnaisse son goût pour la littérature fantastique, elle s’y refuse dans ce cas et ne dévie pas du réalisme avec lequel elle décortique minutieusement l’expérience du deuil : le fantôme pourtant sans cesse épié n’est jamais débusqué.
Contrepoids, chez elle, de la forte présence des nourrissons, du temps de la grossesse et de la maternité, cette attention aux spectres fait partie intégrante de la poétique de Marie Darrieussecq : elle va jusqu’à concevoir l’écriture comme une « disponibilité aux fantômes », une façon de rendre présente l’absence, de faire entendre l’inaudible et de penser, dans des cycles métaphysiques, la rencontre de l’origine de la vie et du silence de la mort.

Selon sa propre expression, Marie Darrieussecq vient d’une « famille hantée ». Sa grand-mère voyait le spectre d’une tante suicidée. Elle la voyait tout à fait incarnée, assise au bord du lit, et l’entendait lui parler de ce qu’elle n’était pas parvenue à dire lorsqu’elle était encore en vie. Marie Darrieussecq y voit une façon détournée de faire un deuil difficile : il est plus facile pour la grand-mère de parler à sa famille d’un fantôme surnaturel que du suicide bien réel de la tante.
« Toutes les familles sont cabossées, abimées, tragiques », explique Marie Darrieussecq. La sienne a eu recours aux présences fantomatiques pour conjurer l’absence de la mort. Il est donc naturel que cette réaction au deuil se retrouve dans son écriture, et l’auteure va plus loin en se demandant : « Pour être écrivain, il faut peut-être accepter d’être le survivant de gens qui n’ont pas réussi à dire certaines choses. » Son histoire familiale a ainsi été très marquée par le décès de son frère aîné avant sa naissance. Cet événement est transposé dans Le Pays et dans la plupart de ses autres livres, mais elle reconnaît ne pas s’y être encore confrontée autobiographiquement. « Il y a des choses que je ne pourrai pas écrire du vivant de mes parents. » Elle se distingue ainsi d’auteurs comme Christine Angot ou Hervé Guibert (elle a étudié le travail d’autofiction de ce dernier dans le cadre de sa thèse), pour qui les besoins de leurs projets d’écriture passent avant les sentiments de leurs proches. Elle se sent, pour sa part, tenue à respecter certains silences, quitte justement à les laisser hanter ses livres comme des spectres.
Petit pays
 Marie Darrieussecq a passé son enfance dans un petit village du Pays basque, avant de faire son lycée à Bayonne, puis de partir vivre à Bordeaux, et enfin à Paris. Elle fictionnalise cette expérience dans son roman Le Pays, qui imagine le retour de la narratrice dans le territoire où elle a grandi. La géographie du livre doit beaucoup au Pays Basque, mais elle ne souhaitait pas, là non plus, que la représentation soit autobiographique : « Je voulais afficher d’emblée que c’était une fiction pour pouvoir dire des choses un peu plus violentes. » Des auteurs basques comme Bernardo Atxaga ou Koxepa Sarrionandia décalent eux aussi leurs livres dans des pays imaginaires. Elle a entretenu avec ce dernier tout une correspondance qui lui a permis de réfléchir à la légitimité ou à l’illégitimité du recours à la violence. Membre de l’ETA dans les années 1980, Sarrionandia a été condamné à perpétuité suite à une prise d’otage qui a tourné à l’exécution, puis s’est exilé à Cuba après s’être échappé, caché dans les baffles d’un concert, d’une prison espagnole. La relation que Marie Darrieussecq a pu entretenir avec lui est un exemple parmi d’autres de ses liens à sa région d’origine. Elle explique qu’elle prendrait la nationalité basque si un jour le pays devenait indépendant, comme elle l’imagine dans son livre, mais qu’elle est fondamentalement non violente.
Marie Darrieussecq a passé son enfance dans un petit village du Pays basque, avant de faire son lycée à Bayonne, puis de partir vivre à Bordeaux, et enfin à Paris. Elle fictionnalise cette expérience dans son roman Le Pays, qui imagine le retour de la narratrice dans le territoire où elle a grandi. La géographie du livre doit beaucoup au Pays Basque, mais elle ne souhaitait pas, là non plus, que la représentation soit autobiographique : « Je voulais afficher d’emblée que c’était une fiction pour pouvoir dire des choses un peu plus violentes. » Des auteurs basques comme Bernardo Atxaga ou Koxepa Sarrionandia décalent eux aussi leurs livres dans des pays imaginaires. Elle a entretenu avec ce dernier tout une correspondance qui lui a permis de réfléchir à la légitimité ou à l’illégitimité du recours à la violence. Membre de l’ETA dans les années 1980, Sarrionandia a été condamné à perpétuité suite à une prise d’otage qui a tourné à l’exécution, puis s’est exilé à Cuba après s’être échappé, caché dans les baffles d’un concert, d’une prison espagnole. La relation que Marie Darrieussecq a pu entretenir avec lui est un exemple parmi d’autres de ses liens à sa région d’origine. Elle explique qu’elle prendrait la nationalité basque si un jour le pays devenait indépendant, comme elle l’imagine dans son livre, mais qu’elle est fondamentalement non violente.
S’il n’y a pas de doute possible quant au pendant réel du « Pays », de nombreux décalages fictionnels sont ainsi mis au service d’un désir de liberté dans l’écriture. « Dans un petit pays, on a des comptes à rendre. » Il est toujours difficile pour les auteurs écrivant en basque ou sur le Pays basque d’éviter que leurs livres soient rapportés à la question du nationalisme. « Deux millions de personnes parlent le basque, dont un million avec aisance. Pour ma part, je suis analphabète en basque, je le comprends mais je ne pourrais pas l’écrire. Le basque a été unifié dans les années 1970, on en a arrêté l’orthographe et les structures, on l’a académisé pour les besoins de l’unité nationale. Mais cette situation de diglossie m’intéresse : ce qui est normal sur la planète c’est de parler au moins deux langues ; être monolingue est une anomalie. »
Écriture féminine, engagement féministe
La condition féminine et le féminisme ont également une place importante dans l’œuvre de Marie Darrieussecq. Elle regrette qu’à l’époque de sa formation, les études de genre aient été peu représentées dans le milieu intellectuel français. Bien sûr, il y avait des figures féminines remarquables dans le monde littéraire’ elle souligne l’importance tutélaire de Marguerite Duras et Nathalie Sarraute’, mais il restait et il reste toujours difficile d’afficher une grande ambition d’auteure lorsqu’on est une femme. « À 25 ans, je débordais d’une colère féministe et sociale. J’étais limitée par le fait d’être une femme, je le ressentais dans l’espace public, où la domination masculine prend des proportions explosives. Cela m’aurait aidée de disposer, par exemple, du concept de harcèlement de rue, mais ça n’existait pas. Cela m’aurait permis de comprendre que je n’étais pas seule à subir cette entrave à ma liberté de circuler. Je le vivais d’autant plus mal que j’écris aussi en marchant, dans une rêverie, et que les types qui s’autorisaient à m’adresser la parole m’interrompaient. L’expérience des jeunes femmes, dans la rue, c’est d’être constamment interrompue dans leurs pensées. Ne parlons pas de la nuit où la peur prend le pas. »
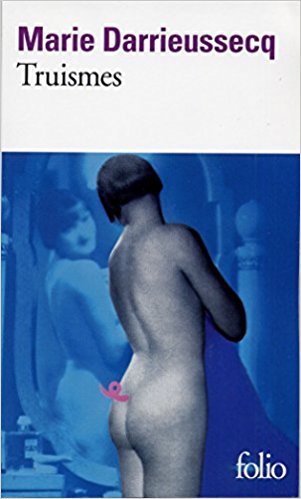
Truismes a été écrit avec cette colère. Marie Darrieussecq y a rêvé quelques mois dans le Paris des grèves contre le gouvernement Juppé de l’automne 1995, puis l’a écrit en six semaines. La narratrice, qui y oscille entre un corps de femme et un corps de truie, y subit des violences dont elle n’a pas conscience, et dont elle rend compte dans une voix naïve, candide, avec trois cents mots de vocabulaire. « Le lecteur sait que ce qu’elle vit est inacceptable, mais elle-même n’en a pas conscience. »
Le succès considérable de Truismes a donné à Marie Darrieussecq une grande place dans l’espace littéraire et médiatique. Il a coïncidé avec une période d’appel d’air qui a favorisé l’émergence d’une nouvelle génération de femmes écrivains, de Christine Angot à Colette Nobécourt en passant par Virginie Despentes ou Lydie Salvayre. Le monde de l’édition était enfin prêt à accueillir ces voix. La littérature lui semble un domaine désormais plus favorable à l’ambition féminine mais de grandes difficultés demeurent dans les arts plastiques ou en musique contemporaine, le plafond de verre le plus épais, le plus solide, étant celui qui empêche les femmes d’accéder à la direction des grands théâtres’ Les clichés et les discriminations continuent aussi en littérature. Marie Darrieussecq donne l’exemple du travail de chroniqueuse qu’elle a mené un temps à Radio France. Le producteur de l’émission voulait qu’elle ponctue le 7-9 de chroniques « légères, féminines », niant par là-même sa capacité à s’emparer d’autres thèmes. Quand, après avoir joué le jeu un moment, elle a voulu changer de ton, elle n’a pas été reconduite : « Je ne faisais pas ce qu’ils attendaient d’une femme, ou du moins ce qu’ils attendaient de moi... »
Des questions du même ordre se posent au sujet de la représentation des femmes dans les fictions. Marie Darrieussecq évoque ainsi le test de Bechdel, initialement suggéré par Virginia Woolf dans Un lieu à soi, qui consiste à se demander, à propos d’un roman ou d’un film : 1) S’il comporte deux personnages féminins identifiables (qui ont un nom) ; 2) Si ces deux femmes ont au moins une scène ensemble ; 3) Si elles parlent ensemble d’autre chose que des hommes. Elle a ainsi été frappée par le biopic récemment sorti sur la vie de Paula Becker, peintre allemande à laquelle elle a consacré son dernier livre, être ici est une splendeur. Il y a, dans la vie de Paula Becker, une scène connue où, visitant une galerie d’art, la peintre a désigné des toiles de Cézanne à son amie Clara Rilke, et lui a dit : « Il y a là une simplicité nouvelle. » Dans le film de Christian Schwochow, cette scène est reprise, mais elle est située dans un bordel, et c’est l’homme qui accompagne et qui courtise Paula Becker qui lui fait ce commentaire et enseigne donc à la jeune femme ce que, dans la vraie vie, elle a appris par elle-même et a transmis elle-même à une amie’
Dans une société structurée par le langage, l’écriture littéraire est un lieu privilégié pour un travail de déconstruction des stéréotypes. Une langue n’est jamais neutre. Le basque, par exemple, est une langue sans genre. Et l’anglais est une langue moins genrée que le français. Quand une femme parle anglais ou basque, elle n’est pas sans cesse obligée de marquer en langue le fait qu’elle est femme. Au rebours, l’espagnol le marque inlassablement. Les règles de la grammaire et de la syntaxe française banalisent d’une certaine manière le sexisme. L’auteure prend l’exemple des petites filles qui entendent durant toute leur scolarité leurs professeur-e-s leur répéter que « le masculin l’emporte sur le féminin ». « Cinquante millions de femmes et un garçon sont contents, faut-il dire. » Marie Darrieussecq rappelle la contingence de cette règle. Jusqu’à la Renaissance, on accordait avec le nom le plus proche du verbe dans la phrase, ou selon le nombre. Elle se permet donc, dans son écriture, d’apporter ce qu’elle appelle des « corrections » à la langue française en accordant au féminin dans certains cas.
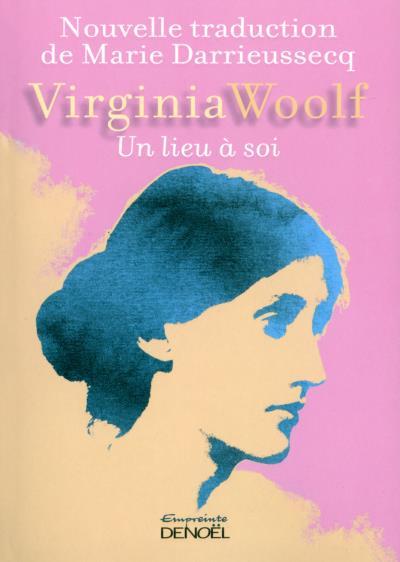
Ce travail sur le genre dans la langue l’a amenée à proposer une nouvelle traduction d’une Chambre à soi de Virginia Woolf sous le titre Un lieu à soi. Elle a ainsi écarté la connotation intime ou sexuelle de la chambre qui n’est pas présente dans la langue originale : Virginie Woolf écrit A Room of One’s Own, et room n’est pas bedroom. Il s’agit de disposer d’un endroit pour écrire, mais qui n’a pas à être une chambre. La manie française de traduire par « une chambre à soi » est donc malvenue, si ce n’est subrepticement sexiste.
L’engagement de Marie Darrieussecq a pu aussi l’inciter à s’emparer de thèmes traditionnellement considérés comme féminins, comme la maternité et l’enfance, pour montrer qu’ils étaient dignes de tous les efforts littéraires. La maternité, dit-elle, lui a apporté une plus grande force d’empathie, mais aussi une plus forte capacité d’inquiétude pour le monde qui vient. Comme le fait également la paternité. « Les enfants donnent accès à l’autre moitié du monde. » Contrairement à de grandes figures littéraires comme Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Virginia Woolf qui ont pris à la lettre l’adage latin Aut liberi, aut libri (Faire soit des enfants, soit des livres), Marie Darrieussecq n’a pas voulu renoncer à l’expérience de la maternité. Elle en donne une vision par fragments dans Le Bébé, un livre qu’elle avait tenu à envoyer à Annie Ernaux, qui l’avait prévenue qu’elle serait en butte à la misogynie. Beaucoup de journalistes ont de fait été désarçonnés par le thème choisi. Un critique a même écrit qu’elle aurait mieux fait de « jeter son livre avec les couches sales de son enfant ». Le bébé semble être un sujet mineur. Il y a pourtant de grands précédents littéraires sur le sujet : comme ces pages de Joyce sur le babil des enfants sur une plage, les bébés présents dans les livres de Toni Morrison, ou les scènes de bain et d’allaitement dans les Mémoires de deux jeunes mariées de Balzac.
Mère de trois enfants, Marie Darrieussecq a dû apprendre dès la naissance de son fils aîné à se concentrer beaucoup plus rapidement : « Avant, je m’installais longuement, je me faisais du thé’ Tout cela participait d’une névrose d’empêchement. Il faut que le temps avant la première phrase soit court. Et il vaut mieux écrire des choses dans un premier temps mauvaises plutôt que de ne pas écrire du tout. Tout est fait pour que vous n’écriviez pas, alors il ne faut pas s’en empêcher soi-même. »
L’acte d’écrire
L’acte d’écrire est souvent représenté dans les fictions de Marie Darrieussecq. Il s’agit souvent de narratrices qui cherchent à raconter ce qui leur arrive. La narratrice de Tom est mort écrit dans un cahier qu’elle fait lire à son compagnon, dont les lectures rythment le livre. Les narratrices du Pays et de Truismes racontent également les événements au fur et à mesure qu’elles les vivent. « Il y a une puissance liée à la forme : « Je suis en train d’écrire. » »
Dans ce cadre, le choix d’une narration à la première ou à la troisième personne revêt une importance cruciale pour Marie Darrieussecq. Chaque option comporte ses spécificités, ses difficultés, et implique une posture très différente. Elle a ainsi débuté l’écriture de son tout dernier roman, consacré à la crise migratoire, à la troisième personne, mais pense qu’il lui faudra tout reprendre à la première personne, et que cela aura des effets sur l’intrigue elle-même. Il faut beaucoup aimer les hommes, à l’inverse, avait été commencé à la première personne, mais le personnage principal étant pour elle une forme d’alter ego, elle a ressenti le besoin de retrouver plus de distance, de redonner au personnage une autonomie en repassant au « elle ». Écrire au « je » permet à l’inverse de mettre en scène l’acte d’écrire, le plaisir et les empêchements. La narratrice peut y ponctuer son récit de formules dynamiques exigeant l’écoute de ceux qui la liraient. La fonction phatique de la langue devient présente et l’adresse aux lectrices et aux lecteurs fait exister ce lien.
Sur la question de la personne d’écriture, lire Claude Simon a été pour elle très éclairant. Dans La Route des Flandres, il passe avec naturel et fluidité du « Je » au « Il ». « Il m’a aussi appris que les transitions n’avaient aucune importance, que les passages qu’on a du mal à écrire sont souvent des transitions inutiles. » Elle a fait ce choix pour Le Pays, écrivant alternativement « je » « elle » et parfois un « j/e » dissocié, cette scission évoquant la tension et la sensation d’être coupée entre Paris et le Pays : « Il aurait fallu écrire J/e, un sujet ni brisé ni schizoïde, mais fendu, décollé. Comme les éléments séparés d’un module, qui continuent à tourner sur orbite. J/e courais, devenue bulle de pensée, la route était libre, j/e courait, j/e devenait la route les arbres le pays. » (Le Pays, Folio, p. 177)
Les questionnements techniques sont souvent inséparables pour elle de questionnements éthiques. Pour son roman en cours, celui, donc, qui traite de la crise migratoire actuelle, elle s’est ainsi sentie astreinte au réalisme. Elle a fait un travail prolongé de documentation, a mené un grand nombre d’entretiens, et recueilli des témoignages plus personnels. Mais ce réalisme la limite dans sa liberté, si bien qu’elle se demande s’il ne faudrait pas trouver une forme de déplacement, en inventant, comme elle l’a fait dans Truismes, un univers parallèle à notre présent où transposer ces problèmes.
« J’écris des livres pour savoir ce qu’il y a dedans », disait Julien Green. Marie Darrieussecq se retrouve dans cette phrase qu’elle cite volontiers. Elle-même découvre ses romans à mesure qu’elle les écrit, et ne fait jamais de plan. Il arrive que lui vienne d’abord un titre, ou une situation initiale qui implique un certain nombre de conséquences que le livre va pouvoir explorer. Dans le cas de Truismes, c’est la voix de sa narratrice, marquée par le type de bêtise que les hommes projettent sur les femmes, qui lui est restée en tête. En relisant ce roman vingt ans après sa parution, elle se rend compte qu’elle aurait pu être plus rigoureuse dans le respect de la cohérence de son personnage : dans certains passages, plus poétiques ou plus sensuels, la narratrice évoque des réalités qu’elle ne peut pas connaître, comme la taïga ou les ruines du Bronx. Ce n’est pas en accord avec le bagage culturel de cette femme qui dispose, le reste du temps, d’une culture peu étendue. Mais elle aime bien penser qu’une sorte de télépathie animale lui a néammoins donné à connaître ces mondes’ C’est le genre de questions qu’elle aime soumettre à son éditeur, Paul Otchakovsky-Laurens (que nous avions reçu en 2016 : voir ici). Sur la cohérence du texte, ou par exemple sur le trop de répétitions. Elle ne partage pas ses brouillons, mais attend que le travail touche à sa fin pour lui présenter le manuscrit complet et lui faire part de ses hésitations.
Les armes de la psychanalyse
Marie Darrieussecq entretient un lien très fort avec la psychanalyse. A l’époque où elle a rédigé Truismes, elle était cliniquement en dépression. Commencer une analyse lui a permis de déléguer sa névrose au divan plutôt qu’à l’écriture, et de concevoir des romans qui s’adressaient à d’autres qu’à elle. « L’écriture, si elle ne devient pas un métier, peut devenir une maladie. Je m’étais donné jusqu’à 40 ans’ La psychanalyse m’a aussi donné des armes. Car pour vouloir devenir écrivain, il faut croire à cette vocation de façon déraisonnable, en assumant une certainemégalomanie. C’est une forme de folie, que Duras par exemple avait. » Le succès fracassant de Truismes ne l’a ainsi pas du tout étonnée, dit-elle en riant. Quatre éditeurs l’ont accepté. Jean-Luc Godard en a acquis les droits pour le cinéma, avant de renoncer au projet. Marie Darrieussecq devait prendre un poste dans le secondaire en septembre 1996 : elle a pu y renoncer et échapper au salariat, ce qui est, souligne-t-elle, une grande chance pour un écrivain.

Plus tard, elle a voulu se former en tant que psychanalyste. « J’avais besoin d’être utile de façon plus directe que cette façon diffuse qu’est écrire. J’avais besoin d’une action plus concrète, et de socialisation, même si là encore, autant peut-être qu’écrivain, être psychanalyste est un métier étrange. » Elle a pratiqué pendant huit ans cette activité qu’elle trouve extrêmement stimulante, mais a dû y renoncer pour le moment car ce métier demande évidemment une grande disponibilité et une sédentarité qui devenaient incompatibles avec ses nombreux voyages.
Cette approche psychanalytique reste forte dans son œuvre. On la retrouve dans l’essai Rapport de police, qui porte sur la question du plagiat, ou dans Tom est mort, qui critique certainsdispositifs thérapeutiques dont on entoure les parents qui ont perdu un enfant. Les « échelles de stress » qui mesurent la profondeur d’un traumatisme font partie des outils mal adaptés dont le roman donne une représentation satirique. La souffrance devient parfois, souligne-t-elle, un marché géré avec un arsenal conceptuel libéral et commercial tout à fait étranger aux expériences qu’il prétend prendre en charge. « Il y a des choses face auxquelles l’âme humaine est irréparable. On ne peut pas adapter les gens à l’insupportable. Et il faut peut-être l’accepter. » Le roman dystopique qu’elle publie à la rentrée 2017, Notre vie dans les forêts, met également en scène une psychologue quelque peu dysfonctionnelle dans un monde tout aussi abîmé.
Billets
Rencontrer Marie Darrieussecq est très stimulant pour de jeunes auteurs. On rencontre une écrivaine avec uné ?uvre bien établie, fourmillant d’idées et de pistes de réflexions littéraires et politiques. Mais également une femme nous parlant de sa pratique concrète de l’écriture. Elle livre de petits détails qui peuvent sembler archaïques mais qui sont pourtant fondamentaux, car un écrivain est d’abord un écrivant et cela nécessite une grande dose de prosaïsme. En l’entendant parler, on ne peut alors s’empêcher de penser à La préparation au roman de Roland Barthes, l’humour en plus.
Marie Darrieussecq nous dit avoir écrit son premier roman en six semaines. Si cela peut sembler au premier abord effrayant’ voire castrateur, on comprend vite que c’est aussi un encouragement de sa part : « Si je l’ai fait, vous pouvez le faire, alors allez-y ! »
A. Deneuville
La rencontre avec Marie Darrieussecq était vraiment passionnante. Avec beaucoup d’humour et de simplicité, elle nous a fait partager sa vie d’auteure, et des bribes de l’environnement plus intime qui la nourrit : famille, terre natale, rapport à la psychanalyse... J’ai particulièrement aimé l’entendre parler de ce glissement de l’écriture qui se décentre en devenant publique, partagée, une écriture qui devient une profession « et non une maladie ». Elle semble parvenir habilement à conjuguer sa vie professionnelle et personnelle, à ménager son espace d’auteure en prêtant attention à la sensibilité de ses proches, à la recherche d’un équilibre entre dire vraiment et ne-pas-tout-dire que je trouve subtil.
Stéphanie Vivier
Comme beaucoup de mes camarades, j’ai beaucoup apprécié cette rencontre avec Marie Darrieussecq, notamment pour la simplicité et l’humour avec lesquels elle parle de son travail, privilégiant une approche pragmatique et décomplexée de la création artistique plutôt qu’une posture de sacralisation et de mythification. J’ai tout particulièrement été interpellé par ce qu’elle appelle « un petit roman nerveux » : un livre dense qui se contente de suivre les conséquences quasi-nécessaires d’une situation de départ bien établie dans l’esprit de l’auteur. Cette conception d’une certaine littérature nue et efficace résonne beaucoup avec le travail d’écriture que je voudrais moi-même mener.
Guillaume Wavelet
par Allan Deneuville, Stéphanie Vivier et Guillaume Wavelet
