Rencontre autour de David Foster Wallace, avec Marion Mazauric et Charles Recoursé

Traduire et éditer David Foster Wallace. Compte-rendu de la rencontre avec Marion Mazauric et Charles Recoursé du 8 mars 2016
par Agnès Blesch, Thomas Casnedi et Rebecca Gisler
entretien réalisé par Vincent Message

Marion Mazauric fonde la maison d’édition Au Diable Vauvert en 2000. Née de la volonté de proposer une littérature française et étrangère réaliste, nourrie de pop culture et mettant en valeur des genres souvent considérés en France comme « mineurs » (la science-fiction, la fantasy, le roman policier), la maison d’édition a notamment contribué à la diffusion en France de l’œuvre de l’écrivain américain David Foster Wallace (1962-2008).
Charles Recoursé débute comme stagiaire au Diable Vauvert en 2006, avant de se voir confier, sur son temps libre, la traduction des œuvres de Foster Wallace. Après quelques années de travail en tant qu’assistant d’édition puis responsable éditorial, il se consacre pleinement à la traduction à partir de 2012.
Le Diable-Vauvert : pop culture et littérature étrangère

Marion Mazauric naît en 1960 à Maisons-Laffitte. Après des études traditionnelles de lettres (hypokhâgne, khâgne, maîtrise de lettres modernes), elle se tourne vers l’édition et travaille pendant treize ans chez J’ai Lu. Elle apprend à y connaître tout un pan de la littérature qu’elle ignorait, des collections érotiques aux romans d’épouvante en passant par la science-fiction. La lecture de Stephen King est pour elle un déclic, « comme si elle découvrait Zola ». L’histoire de Marion Mazauric est celle de toute une génération, à la fois marquée par un héritage de la littérature classique et par la découverte de la pop culture – dont la faible reconnaissance en France participe d’une « nouvelle querelle des Anciens et des Modernes ». C’est d’ailleurs sur ce terreau des pop cultures que se crée sa maison d’édition, perdue dans la campagne près de la petite ville de Vauvert, dans la Camargue gardoise. Animée par le même goût du risque que les toreros de Nîmes, Marion Mazauric laisse de côté sa carrière parisienne pour créer ce que ses interlocuteurs de l’époque appellent « une petite maison d’édition en province ».

L’équipe du Diable Vauvert est en effet restreinte : en plus de Marion Mazauric, on compte une personne au service de presse, une autre au service commercial, une troisième au service juridique et un-e stagiaire. L’idée initiale est de publier des écrivains nourris de pop culture, des écrivains majeurs pour Marion Mazauric même si peu (voire pas du tout) connus en France, tels que William Gibson, Irvine Welsh ou Douglas Coupland. Marion Mazauric prend pour modèle la pratique éditoriale de P.O.L : choisir peu d’auteurs, mais les suivre sur le long terme. En 1999, la future éditrice évoque son projet à une amie qui lui donne à lire Infinite Jest de David Foster Wallace, publié trois ans plus tôt de l’autre côté de l’Atlantique, et déjà considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature américaine. Trois jours après avoir découvert ce livre, et sans en avoir fait une lecture intégrale, Marion Mazauric fait une offre pour acquérir les droits. Cette réactivité fait pour elle partie des qualités que doit avoir un éditeur : « L’art c’est la nuit, le reste du temps on agit ».

Charles Recoursé naît en 1982 à Brest, dans une famille de lecteurs. Il fait ses premières armes sur des polars, du Agatha Christie, des Arsène Lupin, Le Seigneur des Anneaux, jusqu’au jour où il arrête de lire pour aller surfer. Plus tard, il intègre Sciences-Po Rennes mais s’y ennuie très vite. Il repense alors à cette prof de français qui lui avait parlé des Fictions de Borges et se replonge dans la lecture. Il décide dans un premier temps de faire un DESS d’édition et intègre pour un stage la collection Rivages/Noir de la maison d’édition Payot. Montée en 1986 par François Guérif, c’est la première collection en France qui publie les polars en grand format et en traduction intégrale, pour montrer qu’il ne s’agit pas d’une paralittérature. En juillet 2006, Charles arrive à Vauvert pour un stage ; son parcours original, son goût pour la pop culture et sa maîtrise rhétorique du subjonctif plus-que-parfait finissent de convaincre Marion Mazauric de l’engager. Son stage se transforme en CDD, puis en CDI lorsqu’il est nommé responsable éditorial. Sa première traduction pour le Diable Vauvert est celle de Bring the Noise de Simon Reynolds, un livre sur la musique populaire de 1985 à 2000.
La politique de traduction du Diable Vauvert : la recherche d’une langue vraie

L’éditeur est responsable de la traduction des œuvres qu’il publie, et l’enjeu est particulièrement important pour le Diable Vauvert dont le catalogue comprend de nombreux écrivains américains. Au cours de sa scolarité, Marion Mazauric étudie l’allemand, le latin et le grec, mais elle apprend l’anglais « sur le tas », alors qu’elle travaille au sein des éditions J’ai lu. Son goût pour la langue se développe au contact de Jacques Sadoul, amateur de science-fiction et romancier. Marion Mazauric découvre la poésie américaine des années 1970, la langue « archi-contractée » des comics, ainsi que des auteurs comme Henry Miller, ou encore Charles Bukowski. Pour l’éditrice, la langue française a beaucoup été influencée par la langue américaine, le présent devenant par exemple fréquemment un temps de la narration. Marion Mazauric évoque à l’opposée les « livres atones » où l’accumulation des adjectifs et des adverbes sonne de manière désuète.
Par ailleurs, ce que Marion Mazauric appelle le speaking language pose de vraies questions éditoriales : la littérature française compte peu d’exemples de « langage parlé ». L’éditrice évoque Jehan Rictus (1867-1933) et ses Soliloques du pauvre, ancêtre du hip-hop et de la littérature de protestation sociale, Louis-Ferdinand Céline, Raymond Queneau ou encore Émile Ajar, mais précise que ces auteurs restent une minorité dans le paysage littéraire. Ce décalage entre speaking language de la littérature américaine et l’écriture de la littérature française a donné lieu à de mauvaises traductions. Kerouac a par exemple été traduit avec des imparfaits du subjonctif ; les traducteurs faisaient de la langue écrite française là où il y avait de la langue orale américaine, ce qui déformait complètement les œuvres, les vieillissaient, créaient de la distance. De même, le respect très répandu dans l’édition d’un coefficient de foisonnement (marquant l’acceptation du fait que les traductions françaises soient 15% plus longues que les textes originaux anglais) faisaient perdre de la vitesse et de la force de percussion aux œuvres.
Les genres présents dans la catalogue du Diable Vauvert, traditionnellement déconsidérés, ont tendance à être publiés directement en poche, ce qui limite les moyens financiers pour élaborer de bonnes traductions. Le paiement d’une traduction se fait au feuillet et, plus le texte est long, plus la traduction coûte cher sans que le succès ne soit forcément au rendez-vous. Pour Marion Mazauric, il faut donc investir particulièrement dans la traduction et chercher de jeunes traducteurs capables de s’adapter à la langue américaine contemporaine, de se détacher de l’académisme, de ne pas rendre les prétérits par des passés simples. Si Marion Mazauric est attachée aux thématiques « réalistes » des auteurs qu’elle publie, elle est en effet également, et en premier lieu, attachée au réalisme de la langue utilisée comme matériau littéraire.
L’anglais : de la « névrose » à la passion traductrice
Ce n’est qu’en arrivant à Vauvert que Charles Recoursé commence à lire en anglais. Auparavant, il avait simplement la manie de traduire mentalement en anglais une partie de ce qu’il entendait ou lisait, pratiquant ainsi une sorte de thème sauvage. À la suite du premier essai de traduction qu’on lui propose, il se lance dans le livre de David Foster Wallace, La Fonction du balai (The Broom of the System, 1987). De novembre 2008 à mai 2009, profitant du peu de loisirs qu’offrent en hiver les environs de Vauvert, il traduit trois heures par jour après ses horaires de travail, et trois week-ends sur quatre. Il se confronte aux difficultés que présente la langue de Foster Wallace : l’apparente simplicité de certaines phrases est difficile à rendre en français, les changements de registre sont permanents, un mot savant peut ainsi être suivi de l’insulte la plus crasse.
Charles Recoursé pense que les traducteurs doivent se considérer non comme des auteurs, mais comme des « auteurs de traduction », et il associe son métier aux exigences d’honnêteté et de modestie vis-à-vis du texte original. Par exemple, de nombreuses expressions marquant l’hésitation (« as if », « sort of ») participent de l’écriture précise de Foster Wallace : la précision, chez lui, passe par le fait de marquer les approximations et les moindres doutes. Mais la fidélité au texte n’implique pas de traduire systématiquement ces expressions, qui alourdiraient le texte. De même, pour accéder à un registre plus argotique, il ne convient pas de transposer le langage des quartiers populaires français sur l’argot de Brooklyn ou de calquer l’expression parlée « nigger » par le mot « négro ». Il suffit parfois d’enlever des négations, de travailler la langue de l’intérieur pour la rendre nouvelle. David Foster Wallace est un auteur qui demande une « boîte à outils » conséquente, composée de notes prises à la volée dans le métro, de choses entendues au téléphone, saisies au cours de lectures, etc. Ces outils permettent à Charles Recoursé de jouer avec les registres et de proposer une version française riche et intelligente de la « langue de Wallace ».
Traduire est un métier solitaire que Charles a cherché à sociabiliser, notamment par le contact régulier avec d’autres traducteurs comme Nicolas Richard ou Claro, ou d’éditeurs comme ceux d’Inculte. Leurs échanges permettent de créer un contexte de traduction stimulant où le passage de l’anglais au français est constamment interrogé, adapté selon les évolutions de la langue, selon ce que Charles appelle une « alchimie d’époque ». Ils se font également part de projets de traduction qui, pour des raisons d’affinité ou d’emploi du temps, conviendraient mieux à l’un des autres : Charles précise que l’on peut être mauvais sur un texte, même s’il est simple, et très bon sur un autre. La rencontre avec la langue d’un texte peut être concluante ou non : aussi Charles demande-t-il toujours à faire un essai avant de se lancer dans une traduction.
« Ce n’est pas compliqué de reconnaître le génie d’un écrivain, il suffit de le lire »
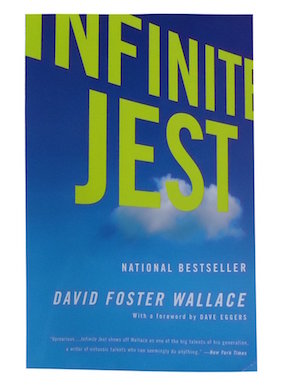
En 2015, Infinite Jest (1996), le livre-culte de David Foster Wallace est publié aux éditions de l’Olivier sous le titre de L’Infinie Comédie. Il avait été refusé par la même maison d’édition, vingt ans auparavant ; à l’époque, le champ littéraire français n’était pas prêt à recevoir le grand œuvre de David Foster Wallace.
Lorsqu’elle achète en 1999 les droits de l’œuvre, Marion est sûre d’avoir trouvé en David Foster Wallace le « Nobel du catalogue ». Ce qui lui plaît particulièrement (sans doute en référence à la culture taurine qu’elle connaît parfaitement), c’est l’audace de l’homme, le risque de soi : David Foster Wallace ose aller dans des zones similaires à celles d’Henry Miller avec Sexus et a vingt ans d’avance sur son époque. Marion Mazauric n’a donc, à l’époque, pas hésité à acheter les droits de toute l’œuvre parue de l’auteur. Le premier contrat pour Infinite Jest ne coûte que 2500 euros. À l’époque, le chiffre d’affaires du Diable est de 500.000 euros ; il a doublé pour atteindre aujourd’hui le million, ce qui classe la maison dans les deux cents premiers éditeurs français. Alors que tout le monde refuse Wallace, Marion, bien connue des agents pour avoir travaillé chez J’ai Lu, qui publie 70% d’inédits et est donc la plus grosse maison d’achats de droits en France, prend le risque. À l’instar de la nouvelle éditrice française, les autres maisons étrangères qui achètent les livres de Wallace sont de petites maisons d’édition indépendante. Les grandes maisons ne souhaitent pas miser sur des livres aussi longs et complexes, et le postmodernisme américain n’a plus le vent en poupe. « En France, nous ne sommes pas fans de l’avant-garde intellectuelle américaine, ni des cultures alternatives. » Pour l’éditrice, ce n’est pas surprenant dans la mesure où notre conservatisme culturel reste fort. À la centralisation du milieu éditorial à Paris, qui laisse peu de chances aux maisons d’édition provinciales de remporter de grands succès commerciaux ou des prix littéraires, correspond aussi une centralisation esthétique et politique, qui privilégie le classicisme formel et des thématiques sociales et historiques loin du tourbillon pop. Le Diable Vauvert est donc d’une certaine manière « hors-jeu ».
L’Infinie Comédie
Les premiers traducteurs de Wallace au Diable Vauvert sont Julie et Jean-René Etienne. Ils se mettent à la traduction d’un recueil de nouvelles, Brefs entretiens avec des hommes hideux, et d’un essai, Un truc soi-disant super auquel on ne me reprendra pas. Le but est de créer un engouement en tentant en 2005 de sortir les deux ouvrages en même temps. Malheureusement, Julie Etienne, malade, se voit contrainte de mettre la traduction de côté le temps de se rétablir. En 2008, alors que le suicide de David Foster Wallace à l’âge de 46 ans sidère tout le monde, Charles Recoursé prend la suite. L’objectif est alors de publier les œuvres de Wallace à un rythme régulier, un livre tous les dix-huit mois.
Dans le monde de l’édition, les contrats sont signés pour une durée de temps précise qui démarre à partir soit de la signature, soit de la première publication de l’œuvre. Le Diable Vauvert met en place une stratégie de long terme en signant un contrat de dix ans et une clause de publication de vingt-quatre mois, qui se voit prolonger par une clause à trente-six mois pour la traduction d’Infinite Jest. Malheureusement pour la maison d’édition, les retards s’accumulent et les droits sont rachetés par Olivier Cohen. Jonathan Franzen, qui y est traduit et a été un ami proche de Wallace, a convaincu le fondateur des éditions de l’Olivier qu’il n’était plus possible qu’un livre si important pour la littérature américaine contemporaine reste inconnu en France. C’est une grosse perte pour Marion Mazauric, même si elle sait que c’est un peu la loi du genre dans un milieu très concurrentiel, et ne blâme pas Olivier Cohen d’avoir « fait son boulot ». « C’est le devoir des grandes maisons d’aller chercher chez les indépendants les auteurs qu’ils ont manqué plus tôt. » En Italie aussi, minimum fax doit jeter l’éponge face à un grand groupe. « Mais la perte des droits, ç’a été un choc secondaire par rapport à la perte de l’homme », dit Marion Mazauric qui n’aura jamais eu l’occasion de le rencontrer.
Dans un premier temps, l’Olivier confie la traduction d’Infinite Jest à Francis Kerline, avec lequel ils ont l’habitude de travailler. Mais au bout de quatre ans, alors que le projet a à son tour pris du retard, et que ce travail titanesque vire au cauchemar pour Kerline, l’Olivier rappelle Charles Recoursé pour lui demander de traduire les notes de fin d’ouvrage, qui comptent plus de 350.000 signes. La tâche a quelque chose de frustrant, puisque « cela revient à faire les chutes de blague quand on n’a pas eu les blagues », mais elle reste intéressante, puisque certaines notes sont extrêmement développées, et que les trajectoires de certains personnages principaux s’y achèvent. Les contacts entre les deux traducteurs étant très limités, une relectrice travaille ensuite à l’harmonisation du tout.
« Traduire Le Roi Pâle, c’est voir l’ombre d’une montagne dans une prairie, quand on ne peut pas lever les yeux »
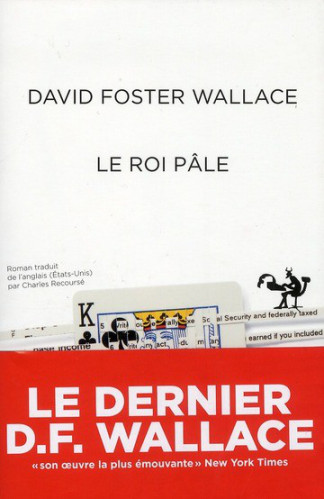
Après la mort de Wallace, sa femme Karen L. Green retrouve sur son bureau un dossier de 250 feuillets qui composent des chapitres non linéaires, présentant les bases d’une intrigue non terminée. Wallace n’avait pas l’habitude de toucher d’à-valoir sur un livre en cours, car il trouvait que cela faisait monter la pression, mais il avait besoin d’argent et avait destiné ce dossier à son agente, Bonnie Nadell, pour qu’elle se mette à prospecter chez les éditeurs. On retrouve aussi des cahiers de notes, des disques durs, de multiples versions imprimées de différents chapitres. Après de longues tergiversations, l’éditeur américain Michael Pietsch, la femme et l’agente de Wallace décident d’essayer de leur trouver un ordre et d’en faire un roman publiable, même si ce travail dépasse les attributions ordinaires du métier d’éditeur.
Pour Charles Recoursé qui a traduit cet ouvrage posthume en une demi-année intense, le lecteur n’a en main que l’esquisse de quelque chose qui aurait été infiniment plus important. On y trouve mis en scène un centre d’impôts dans lequel règne une lutte de pouvoir entre ceux qui croient encore en une vision sociale de l’État, et ceux pour qui l’État doit fonctionner comme une entreprise et viser la rentabilité. Après L’Infinie Comédie, qui prenait pour personnages principaux de jeunes lycéens engagés dans l’apprentissage intensif du tennis, et tenait encore du campus novel,c’est un livre de l’âge adulte, qui décide de ne pas fermer les yeux sur l’ennui qu’on peut y ressentir, mais de le prendre à bras-le-corps. Pour Charles Recoursé, « il y a peu d’auteurs qui prennent leurs lecteurs pour des adultes, et qui se disent à ce point : je vais leur infliger de s’emmerder, à la fois beaucoup plus et d’une manière beaucoup plus intéressante que ce qu’ils ont jamais fait de leur vie. » Marion Mazauric ajoute que l’une des choses qu’elle trouve les plus belles dans ce roman, c’est l’empathie de l’écrivain pour ses personnages, même pour ceux qui exercent les activités a priori les plus austères. On retrouve ça dans C’est de l’eau, un ouvrage qui, dit-elle, « nous a été laissé pour qu’on ne se suicide pas, pour trouver des solutions dans ce monde. Chez Wallace, la conscience du désespoir est le fait premier. Et puis après on se marre. » Alors que David Foster Wallace, suicidaire depuis ses 18 ans, cachait ses épisodes de dépression à ses amis, alors qu’il disait ne pas savoir vivre ni écrire sous anti-dépresseurs, il nous a légué une œuvre où l’ironie reste liée à une profonde empathie pour les autres.
Billets
L’art du dialogue, c’est sans doute ce qui m’a le plus subjuguée dans l’œuvre de David Foster Wallace. Ce speaking language dont parle Marion Mazauric voit son éclatante incarnation dans l’écriture vive et décalée de l’écrivain. À ces dialogues qui sonnent « juste » est associée une maîtrise de la notation, étranges didascalies d’une Infinie Comédie, où l’accumulation de micro-observations, le « réalisme hystérique » tel que l’entend James Wood côtoie la description de traits de caractères étranges. Ce langage qui nous semble naturel et tellement moins artificiel que les dialogues poussifs censés faire avancer les intrigues, participe de cette stratégie de défamiliarisation : réponses à côté de la plaque, remarques déplacées, commentaires impromptus. Les paroles se coupent, ne se répondent pas, mais parfois font surgir autre chose, ce que l’on n’attendait pas. À l’image d’un des personnages de L’Infinie Comédie, David Foster Wallace est un « conversationnaliste professionnel ».
Agnès Blesch
J’ai toujours aimé la littérature américaine. Je pense à Hemingway, Steinbeck, Wright, Bukowski, Iceberg Slim... La liste pourrait se rallonger. J’ai toujours préféré ces grands espaces, ces paysages urbains, ces histoires si représentatives d’un pays-continent tout en diversité et en paradoxes, et pourtant. Pourtant, cette rencontre m’a amené à me poser cette question : que fais-tu du traducteur ? C’est vrai, je ne dis jamais « je lis la traduction de tel ou tel auteur », et je pense que, comme moi, une grande partie du lectorat oublie le travail considérable du traducteur. Charles Recoursé a utilisé l’expression « auteur de traduction », elle m’a paru tout à fait juste. Le traducteur, de chair et d’os, n’est pas un outil informatique capable de (souvent mal) restituer un texte dans la langue que l’on veut. C’est un stakhanoviste de la langue, un passionné qui n’hésite pas à s’infliger des heures supplémentaires. Cet ouvrier qui ne referme que rarement sa boîte à outils. Ce travailleur de l’ombre dont le nom est bien souvent inconnu (sauf par une minorité avertie), éclipsé par la typographie clinquante sur la couverture et la renommée de celui qu’il traduit. On croit lire du Pynchon, on lit en réalité les traductions de Claro ou de Nicolas Richard. On découvrait Borges sans penser à Paul Verdevoye. En somme, le traducteur est un « ghost rewriter ». Il faudrait ne jamais oublier sa tâche délicate et fastidieuse qui fait de lui un lien entre lecteurs et auteur étranger et se rappeler que le traducteur est celui « qui fait passer ». Un humble passeur.
Thomas Casnedi
Par Agnès Blesch, Thomas Casnedi et Rebecca Gisler
